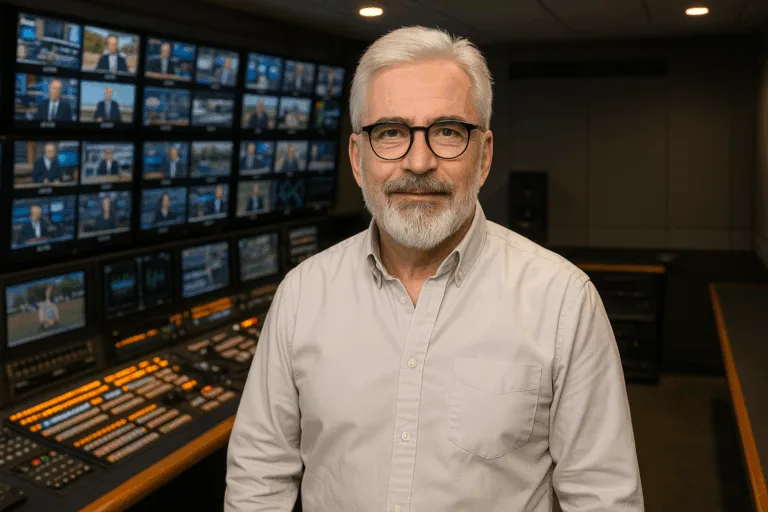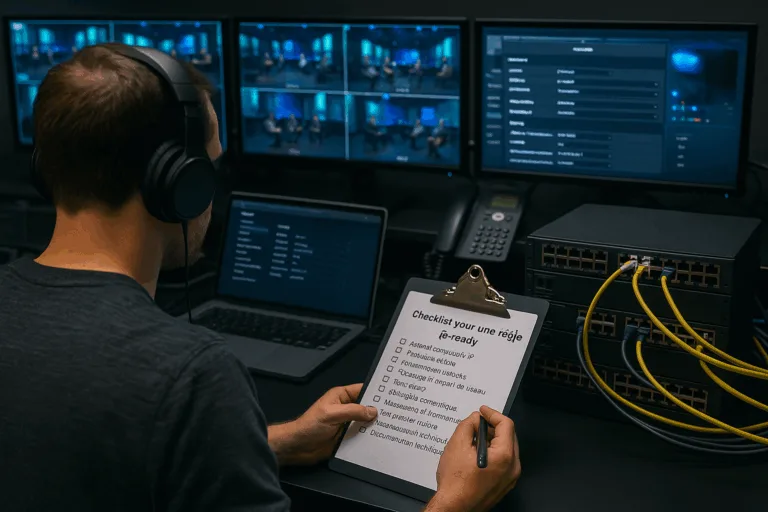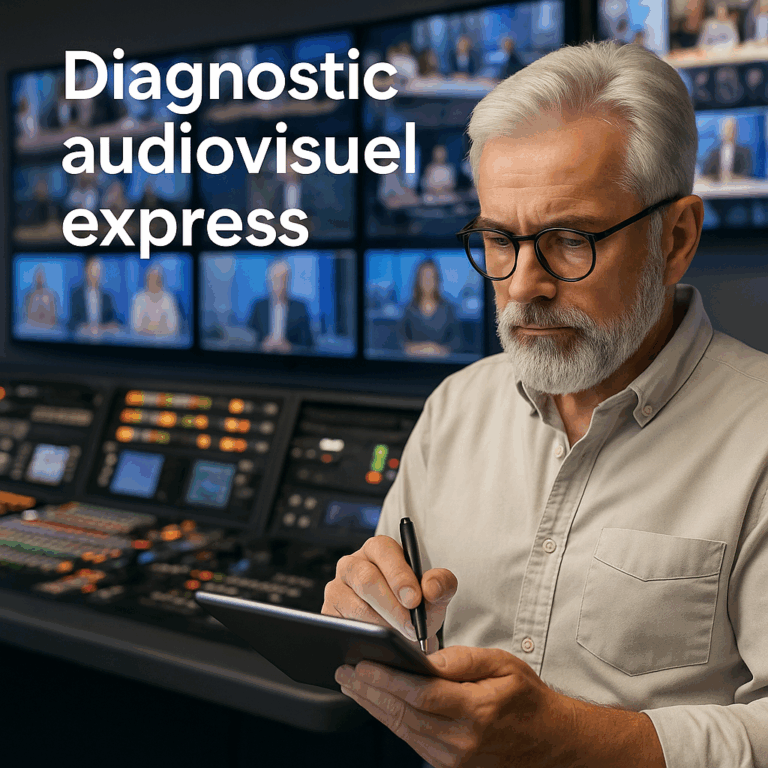Checklist réseau – Pour garantir des flux vidéo IP stables
Ce qu’il faut mettre en place pour éviter les gels, les pertes ou la désynchronisation
Chapeau
La migration vers des workflows IP transforme l’approche des régies, studios et installations audiovisuelles. Mais cette transition repose sur une base technique souvent sous-estimée : l’état du réseau local. Trop de dysfonctionnements audio/vidéo (gel d’image, coupure, latence, désynchro, caméra invisible…) ne proviennent pas d’un matériel défectueux, mais d’un réseau mal préparé. Voici une checklist professionnelle pour garantir des flux IP stables et fiables, qu’ils soient en NDI, SRT, Dante AV, ST2110 ou autres.
1. 📶 Une bande passante suffisante (et stable)
La bande passante disponible ne se mesure pas uniquement en “Gigabit” théorique. Chaque flux vidéo occupe une portion réelle et continue du réseau : un flux NDI Full peut consommer jusqu’à 150 Mbps, un flux NDI|HX entre 10 et 20 Mbps, un flux SRT compressé tourne entre 4 et 12 Mbps selon le profil d’encodage.
Sur un switch Gigabit partagé entre 10 appareils, la saturation est vite atteinte, surtout si les flux sont bidirectionnels (retour vidéo, intercom, contrôle).
Bonne pratique : anticipez votre besoin réel, additionnez tous les flux simultanés, et gardez au moins 30 % de marge pour absorber les pics d’activité, les backups invisibles, ou les overlays dynamiques. Ce n’est pas une option : c’est une garantie de fluidité.
2. 🕓 Une latence réseau maîtrisée
La latence est le temps que met un paquet à faire l’aller-retour sur le réseau. Même si un protocole comme SRT intègre un buffer de sécurité pour absorber le jitter, une latence trop élevée finit par dégrader l’expérience — en particulier pour la synchronisation son/vidéo, les retours moniteurs en plateau ou les captations multi-sites.
Pour de la vidéo live, la latence réseau doit idéalement rester sous les 80 ms, et sous les 50 ms si vous gérez de l’interaction entre plateau et régie distante.
Utilisez des outils simples comme ping, tracert, ou iperf pour évaluer la qualité de vos liens internes. Attention aussi à certains switchs d’entrée de gamme qui ajoutent une latence cachée dès qu’ils sont saturés.
3. 🧩 Des flux bien isolés (VLAN, réseau dédié)
Le réseau audiovisuel ne doit pas partager son espace avec les usages bureautiques classiques : impression réseau, navigation web, mise à jour des OS ou synchronisation de cloud personnel. Un simple poste bureautique qui se met à jour pendant un live peut créer un goulot d’étranglement fatal.
L’approche professionnelle consiste à segmenter le réseau :
- Soit physiquement (deux réseaux Ethernet séparés),
- Soit logiquement (via des VLAN configurés sur un switch manageable).
Le VLAN audiovisuel permet de limiter la diffusion des paquets inutiles, d’optimiser les temps de réponse, et d’éviter les conflits d’IP. Il devient même obligatoire si vous déployez du Dante, du ST2110 ou du NDI full en multicast.
4. 🎯 Un switch vraiment adapté à l’audiovisuel
Le switch réseau est le cœur de toute infrastructure audiovisuelle IP. Il ne doit pas être choisi uniquement pour son prix ou son nombre de ports, mais pour sa capacité à gérer des flux temps réel, stables, synchronisés, parfois multicast, parfois cryptés.
Voici les critères indispensables :
- Manageable : configuration fine des VLAN, IGMP, QoS, etc.
- Backplane solide : une bonne capacité de commutation (non bloquante)
- IGMP Snooping actif : crucial pour filtrer le multicast (NDI, ST2110)
- QoS configurable : pour prioriser les paquets vidéo/audio critiques
- PoE (Power over Ethernet) si vous alimentez des caméras, interfaces ou intercoms
Oubliez les switchs non manageables ou les “mini-switchs” de bureau. Privilégiez des gammes comme Netgear M4250/M4300, Cisco SG, TP-Link Jetstream, ou encore Ubiquiti UniFi Pro si votre réseau est unifié.
5. 🛠 Activer les bons réglages (QoS, IGMP, Jumbo Frames)
Un bon switch n’est rien sans une bonne configuration.
- IGMP Snooping permet de ne diffuser les flux multicast que là où ils sont utiles, évitant ainsi la saturation des ports.
- QoS (Quality of Service) permet d’attribuer une priorité haute aux paquets critiques (vidéo, audio, intercom) pour qu’ils ne soient pas retardés par des paquets moins importants.
- Jumbo Frames (MTU 9000) permet d’optimiser le transfert de paquets lourds en réduisant le nombre d’en-têtes et de fragments.
Ces options doivent être testées sur votre matériel et validées par rapport à vos protocoles (NDI, Dante, SRT…). Mal configurées, elles peuvent au contraire dégrader le trafic. En cas de doute, réalisez un test A/B.
6. 🧠 Plan d’adressage IP clair et documenté
Un réseau bien structuré commence par un plan d’adressage IP rigoureux.
Trop de problèmes naissent de conflits d’adresse IP, de doublons, ou d’appareils non identifiés. Attribuez à chaque équipement (caméra, convertisseur, régie, serveur, interface audio) une IP fixe ou réservée via DHCP, sur une plage cohérente.
Créez un tableau avec :
- Le nom de l’appareil
- Son type / rôle
- Son IP fixe ou réservée
- Son adresse MAC (utile en cas de remplacement)
- Son emplacement ou affectation (studio, régie, plateau…)
Stockez ce document dans un drive partagé avec l’équipe technique. Cela fait gagner un temps précieux en cas de dépannage ou de déploiement rapide.
7. 📊 Un monitoring réseau en temps réel
Un bon réseau est silencieux… mais un bon réseau professionnel est aussi surveillé. Installer une solution de monitoring permet de :
- Visualiser la charge de chaque port du switch
- Détecter les flux dormants, les pics d’usage ou les microcoupures
- Alerter en cas de perte de flux, chute de débit ou latence excessive
Des outils comme LibreNMS, PRTG, Zabbix, ou même Ubiquiti Controller si vous êtes sur cette gamme, permettent une vue synthétique de votre infrastructure. Intégrez des alertes (email, Slack, Telegram) pour réagir avant que le public ne voie le problème.
8. 🔄 Tester à charge réelle
Le test « à vide » avec une seule caméra ne suffit pas. Vous devez simuler la charge réelle de la captation, avec :
- Toutes les caméras actives
- Les overlays, transitions, flux audio, enregistrement
- La diffusion ou contribution simultanée (SRT, RTMP, etc.)
- L’usage des postes de monitoring
Un switch peut paraître fiable tant qu’il n’est utilisé qu’à 30 %. Mais c’est lorsqu’il atteint 80–90 % que les latences apparaissent, que les erreurs s’accumulent ou que les paquets sont dropés.
Faites un test complet. Toujours.
🎯 Conclusion
La vidéo sur IP est une opportunité majeure pour moderniser les workflows, mais elle transforme les équipes audiovisuelles en véritables exploitants réseau. En suivant cette checklist, vous bâtissez une infrastructure solide, évolutive, résiliente, capable d’absorber la complexité croissante des captations hybrides, des régies distantes, ou des studios cloud-ready.
Mieux encore, vous faites de votre réseau un allié stratégique, au lieu de le subir.
🧩 Vous avez un doute sur la stabilité de votre réseau audiovisuel ?
Chaque flux vidéo qui gèle ou disparaît est peut-être un simple problème de switch, de QoS ou de saturation réseau. Je vous propose une assistance technique à distance pour diagnostiquer, corriger et fiabiliser votre infrastructure, que vous soyez en NDI, SRT, Dante AV ou ST2110.
👉 Profitez de mon support réseau à distance sur AVPRO.wayenborgh.fr et sécurisez vos captations avant qu’un problème n’interrompe votre production.